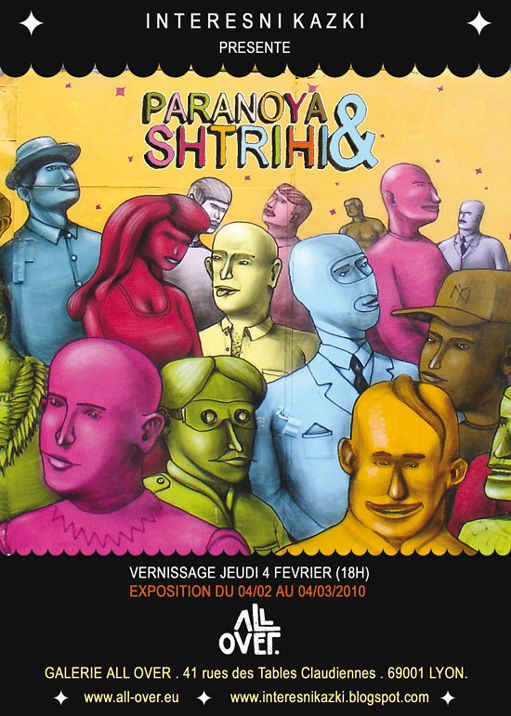Le graffiti, une pratique de soi
Depuis peu, et encore en ce moment, les expositions de graffiti se multiplient à Paris dans des lieux où on les attendait a priori le moins, tels que la Fondation Cartier ou le Grand Palais. Comme si ces pratiques picturales «nées dans la rue», dans l'exclusion et la misère urbaines, venaient de leur plein gré se jeter dans la gueule du loup : ces hauts lieux du luxe, du pouvoir et de l'argent qu'elles ont peu ou prou longtemps provoqués; ou ces hauts lieux consacrés de la culture muséale qui les ont si longtemps méprisées et ignorées.
On sait en effet que la pratique picturale du graffiti est apparue au début des années 1970 dans les quartiers pauvres et les ghettos noirs et hispaniques de New York, avant de gagner d'autres grandes métropoles, de Sao Paulo à Amsterdam, de San Francisco à Paris, Londres, Berlin… La singularité de la pratique picturale du graffiti réside dans le fait qu'elle s'exerce sur la multitude des surfaces que la ville offre aux regards, mais qu'elle protège de toute intervention : les pans de murs immaculés, les palissades de chantiers, et très tôt à New York l'intérieur et l'extérieur des rames du métro.
Exercé dans la rue, mais surtout sur des surfaces interdites, le graffiti est une pratique picturale illégale, exposée aux poursuites de la police et de la justice. Une pratique à risque, nécessairement clandestine. Une pratique de défi permanent lancé aux autorités, aux pouvoirs, aux forces répressives. En somme, victimes d'exclusion sociale ou raciale, et pour la plupart relégués dans les périphéries déshéritées des grandes villes, les graffeurs reproduisent dans leur activité picturale leurs conditions de vie.
Lire la suite